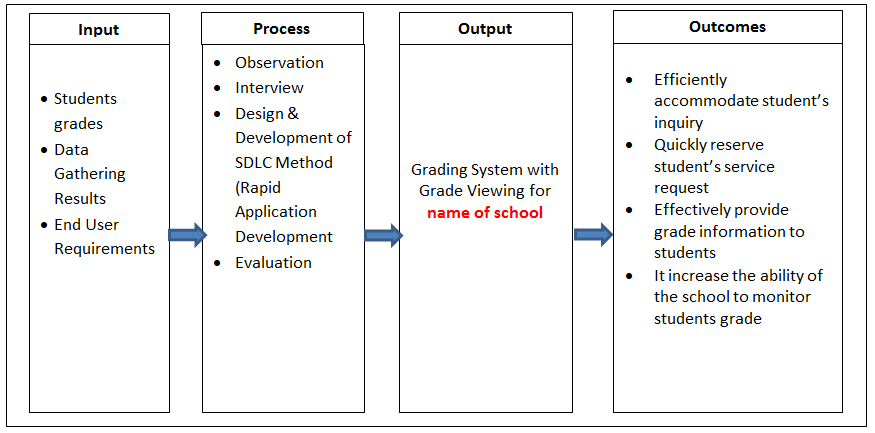Christophe Aguiton
(English/Español) Parler d’« alternatives systémiques » impose de s’intéresser aux concepts ou expériences issus de pratiques sociales réelles, qu’ils aient émergés récemment ou dans le passé, et qui tous remettent en cause tout ou partie du système de domination contemporain. Et d’aborder la « mise en actions » de ces alternatives, il faut se poser la question de leur gestion, c’est à dire des modèles démocratiques qui en assurent la régulation.
Depuis trente ans, la question démocratique est un enjeu majeur, mobilisé par de très nombreux acteurs dans leurs différents combats. L’effondrement de l’Union soviétique et des régimes qui lui étaient associés a conféré aux États-Unis le statut d’unique superpuissance, utilisant la démocratie comme une valeur cardinale pour assurer son hégémonie. Dans les années 1990, la « démocratie de marché », sera ainsi le vecteur de la mondialisation néolibérale pendant la courte période historique où les États-Unis défendront le multilatéralisme. Puis celle-ci sera associée à la lutte contre le terrorisme pour justifier les interventions militaires au Moyen-Orient. Dans une période plus récente, la démocratie est de nouveau convoquée, mais cette fois-ci pour défendre des modèles différents de ceux prônés par les gouvernements occidentaux : Victor Orban en Hongrie et plusieurs de ses homologues en Europe de l’Est se réclament de la démocratie « illibérale » et, en Asie, plusieurs gouvernements suivent l’exemple chinois de régime autoritaire tout en maintenant une apparence, parfois ténue, de fonctionnement démocratique.
Les acteurs des mobilisations de ces dernières décennies, le mouvement altermondialiste, les manifestants du printemps arabe, puis ceux des mouvements Occupy ou Nuits debout vont, eux aussi, placer la démocratie au cœur de leurs revendications. Une exigence d’autant plus forte qu’elle se heurte aux pratiques jugées anti-démocratiques des institutions internationales, du FMI à l’OMC, qui imposent des mesures d’austérité ou donnent la priorité aux intérêts des entreprises multinationales, quel qu’en soit le prix pour les populations locales. Toutefois, la définition de la démocratie, auquel se réfèrent ces mouvements, reste imprécise. Elle est parfois comprise comme un simple synonyme de droits civiques et de démocratie représentative, basée sur l’élection de représentants qui gèrent, au nom du peuple, les institutions, une ville ou un État. Ou on la limite au respect de la souveraineté populaire face aux institutions internationales. Ou bien encore, dans la volonté de dépasser ces formes traditionnelles, on la revendique comme une « vraie démocratie », mais aux contours souvent assez flous. Quant à nous, nous affirmons que les alternatives systémiques font appel à des modes de gestion originaux qui ouvrent des pistes pour penser une « démocratie radicale ». Mais commençons par revisiter les modèles traditionnels de démocratie.
La démocratie représentative trouve ses racines dans les révolutions française et américaine du xviiie siècle, époque à laquelle les constituants de l’époque, Sieyès en France ou Madison aux États-Unis, estimaient que le peuple n’était pas vraiment capable de décider de lui-même. Ils ont donc mis en avant l’élection des gouvernants avec deux préoccupations : instaurer une relation gouvernants-gouvernés par laquelle les seconds acceptent le pouvoir des premiers, et garantir l’appartenance de ces derniers à l’élite.1. Un système qui a évolué au cours du temps, en particulier avec la généralisation du suffrage universel au xxe siècle, mais qui continue à faire l’objet d’une double critique : il favorise la reproduction des élites et l’appartenance des gouvernants aux classes dominantes les rend incapables de s’opposer aux diktats des entreprises multinationales, des marchés financiers et, plus généralement, aux règles de la mondialisation néolibérale.
Le mouvement ouvrier et les partis politiques de gauche n’ont pas vraiment proposé d’autres modèles de fonctionnement démocratique. Karl Marx avait tiré les leçons de la Commune de Paris2 en expliquant qu’il fallait un autre type d’État que celui issu de la bourgeoisie et en avançant l’idée d’un gouvernement du mouvement ouvrier. Des propositions discutables3, telles que la fusion des fonctions législatives et exécutives, qui seront écartées par la social-démocratie européenne à la fin du xixe en faveur de la conquête des libertés politiques et du suffrage universel dans le cadre des systèmes politiques existants. Les leçons de Marx seront reprises par les théoriciens de l’aile gauche de la social-démocratie – le néerlandais Anton Pannekoek, dès 19124 puis Lénine en 19175 – et la vague révolutionnaire qui traversa l’Europe à la fin de la Première Guerre mondiale verra l’émergence de nouvelles formes politiques, les soviets en Russie, les conseils ouvriers en Allemagne ou en Hongrie. Mais l’expérience soviétique tournera vite le dos aux espérances démocratiques que ces nouvelles formes avait suscitées.
À l’exception de petits courants minoritaires, libertaires ou conseillistes, l’essentiel du mouvement ouvrier se divisera, au xxe siècle, entre des partis communistes défendant le modèle soviétique et des sociaux-démocrates, socialistes ou travaillistes, qui s’intégreront de manière a-critique dans le système représentatif des démocraties occidentales. Oubliées, les mises en garde des philosophes des lumières comme Montesquieu6 qui rappelaient que les Athéniens du siècle de Périclès avaient choisi le tirage au sort et la démocratie directe pour ne pas priver le peuple du pouvoir réel. Récemment, David Graeber7 a proposé une autre approche en s’intéressant aux pratiques démocratiques des nations amérindiennes ou à celles des pirates de l’âge d’or de la piraterie8, au tout début du xviiie siècle. Des expériences basées sur des processus de décision égalitaires dans des communautés éloignées des pouvoirs de l’État. Il s’inscrit en cela dans la lignée de James C. Scott9 qui a travaillé sur les populations des hauts plateaux d’Asie du Sud-Est qui se sont passées d’État pendant des décennies, voire des siècles. Des expériences utiles car elles se situent à une distance certaine des pouvoirs d’État.
La démocratie des communs
Les communs sont un mode particulier de relation sociale dans laquelle un groupe de personnes humaines gèrent en commun un bien matériel ou immatériel. En cela, les biens communs sont différents de la propriété privée des moyens de production, centrale pour le système capitalisme, l’État et ses institutions10.
Ce qui nous intéresse ici sont les caractéristiques de cette « gestion commune » de biens aussi différents que l’eau irrigant les oasis, les prés des alpages, les coopératives de production ou les biens communs du numérique comme Wikipedia ou Openstreetmap. Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie, a théorisé les règles de gestion spécifiques à tous ces biens communs11. Il s’agit de huit principes :
- définition claire de l’objet de la communauté et de ses membres,
- cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature de celle-ci,
- participation des utilisateurs à la modification des règles opérationnelles concernant la ressource commune,
- responsabilité des surveillants de l’exploitation de la ressource commune,
- graduation des sanctions pour non-respect des règles d’exploitation de la ressource commune,
- accès rapide à des instances locales de résolution des conflits,
- reconnaissance de l’auto-organisation par les autorités gouvernementales,
- organisation multi-niveaux des activités d’appropriation, d’approvisionnement, de surveillance, de mise en application des lois, de résolution des conflits et de gouvernance.
Ces principes se retrouvent dans tous les biens communs. À défaut, le « commun » risque de se transformer en entreprise classique. Ainsi des nombreuses banques mutualistes ou coopératives agricoles dont le management s’est détaché des utilisateurs et qui se sont converties en multinationales, à l’image de Lactalis, leader mondial de l’industrie laitière. Ces exemples mettent en évidence une difficulté récurrente des biens communs, d’autant plus faciles à gérer qu’ils sont à taille humaine.
D’importants biens communs du numérique ont cependant réussi à garder leur spécificité en dépit de leur dimension mondiale. Wikipedia est le principal outil d’accès à la connaissance qu’ait connu l’humanité avec, en 2018, plus de 50 millions d’articles en près de 300 langues et plusieurs centaines de milliers de contributeurs actifs. La gestion de Wikipedia est un exemple du respect des principes édictés par Elinor Ostrom12. Les règles d’éditions et le principe de neutralité sont clairement explicités et les utilisateurs sont associés à la définition des règles communes ; les sanctions sont prononcées en dernier recours après de longue phases de discussion et de médiation ; la résolution des conflits est confiée à des gestionnaires au plus près des utilisateurs, dans un système où coexistent différents niveaux de surveillance et de gouvernance. Le premier des principes de fonctionnement d’une organisation aussi vaste et complexe que Wikipedia est de renvoyer les décisions aux extrémités, au plus près des utilisateurs. Une caractéristique importante car cette proximité dans les processus de décision rapproche l’encyclopédie en ligne des biens communs situés localement. Elle s’inscrit aussi dans la logique de la « déglobalisation » ou de la décroissance qui met l’accent sur la relocalisation de l’économie et des échanges, en privilégiant les circuits courts et les relations directes entre producteurs et consommateurs.
Les pratiques alternatives de l’écoféminisme, du Buen vivir et des droits des non-humains
Relocaliser l’économie et les échanges est une étape essentielle pour « réencastrer l’économie dans la société », pour reprendre la célèbre formule de Karl Polanyi13. Les premières militantes écoféministes américaines et les mouvements indigènes des pays andins qui défendent les droits des non-humains et le « buen vivir » s’attaquent à un autre défi : la césure nature/culture issue du cartésianisme et de la philosophie de la modernité européenne.
Les mouvements indigènes des pays andins défendent les droits des non-humains et le buen vivir (ou vivir bien) comme deux aspects indissociables de leur vision du monde, 14. Une cosmogonie basée sur l’idée du « tout », vie et mort, humain et nature, passé et futur, où le tout se construit sur des couples opposés, homme/femme, individu/communauté, humain/nature, où il n’existe pas de conception linéaire du temps et du progrès et où prime l’idée du « prendre soin » – de soi, de sa communauté et de l’ensemble indissociable humains et non-humains. L’arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes en Bolivie et en Équateur dans les années 2000 a conduit à des réformes constitutionnelles majeures en introduisant le buen vivir et les droits des non-humains dans les lois fondamentales ainsi que le concept d’État multinational et multiculturel. Ces avancées ont ouvert des possibilités qui ne se sont pas réellement concrétisées, les gouvernements d’Evo Morales et de Rafael Correa ayant imposé un tournant extractiviste et une forte personnalisation du pouvoir dans les années 2010.
Mais les potentialités de ces concepts sont toujours présentes15, la Constitution bolivienne établit ainsi l’existence de trois formes de démocratie : représentative, participative et communautaire. Ainsi peuvent coexister des formes classiques de représentation politique avec des processus de décision basés sur le consensus, et cela sans nier l’existence de tensions non résolues, comme l’équilibre entre droits et devoirs dans les communautés indigènes dans lesquels priment les devoirs ; ou encore le risque que la nomination des autorités par paires, homme/femme, dans l’esprit de la cosmogonie du buen vivir, ne soit qu’une équité symbolique, les femmes étant réduites à un rôle passif dans la vie publique.
Les premières militantes écoféministes américaines se sont mobilisées, dès les années 1970, contre les pollutions et les atteintes à l’environnement en se trouvant confrontées à deux rejets, issus d’une vision anthropocentrique caractéristique de la modernité européenne. Pour la majorité des féministes, le lien à la nature revendiqué par les écoféministes renvoyait à un essentialisme cantonnant les femmes à leur rôle « naturel », lié à l’enfantement. Elles refusaient de voir que les écoféministes ne cherchaient en rien à valoriser un « rôle » de femme lié à leur essence mais à inverser un double stigmate, celui de l’infériorité de la nature à la culture et des femmes aux hommes. Les écoféministes veulent réhabiliter, se réapproprier – reclaim en anglais – la nature, et ce pour toute l’humanité et pas seulement les femmes16. Mais ce faisant, elles se sont aussi heurtées aux mouvements écologistes dominants aux États-Unis, comme le Sierra Club, fondé à la fin du 19ème siècle à l’initiative de John Muir qui avait théorisé le concept de « wilderness », de nature sauvage qu’il faut protéger des activités humaines. Pour le Sierra Club, les femmes qui luttaient contre la pollution s’affrontaient à une question de santé publique et non d’environnement, acceptant de fait, même si c’est au nom de la protection de la nature, la césure nature/culture que les militantes écoféministes allaient remettre en cause en mettant en avant le concept de « justice environnementale »17. Sur le plan politique les écoféministes américaines, souvent des femmes d’origine afro-américaine ou native-américaine, se tiennent éloignées des institutions et du gouvernement. Ces mouvements pratiquent, à l’écart de l’État, des formes de démocratie basées sur le soin de l’autre, sur le « care », dans des expériences collectives où s’inventent de nouveaux rapports sociaux et à la nature.
Au delà des différences évidentes entre les pratiques alternatives présentées rapidement ci-dessus, on retrouve deux éléments identiques. Le premier est l’éloignement des institutions étatiques – évident pour les communs, qui sont une alternative tant au capitalisme qu’à l’étatisme, mais vrai également pour le buen vivir ou l’écoféminisme dont les expériences collectives ont leur autonomie et leur indépendance. Le second élément est l’idée du « prendre soin », du « care ». C’est le cas pour les communs : une caractéristique identique traverse des réalités aussi différentes que les biens communs paysans issus des société précapitalistes, les coopératives ouvrières ou les communs du numérique comme Wipipedia ou Openstreetmap. Si l’on n’en prend pas soin ils meurent, en intégrant le système capitaliste ou en tombant en désuétude. Cette obligation du prendre soin est également au cœur de l’écoféminisme et du buen vivir. Ces deux facteurs sont très importants mais ne sont pas les seules leçons à tirer de ces pratiques.
Gérer les pratiques alternatives de manière démocratique
La démocratie, dans son acception la plus large et la plus simple, est un moyen pour gérer des activités humaines, un parmi d’autres car un grand nombre de ces activités ne le sont pas de manière démocratique, à commencer par les entreprises en système capitaliste. Mais ce constat ne vaut pas définition, et celle-ci est tout sauf évidente. À commencer par la formule la plus utilisée « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » qui laisse ouvertes toute une série de questions : des plus simples comme la nécessité d’avoir un État de droit au niveau national et des garanties de même nature à tous les niveaux de gestion des activités humaines, aux plus controversées comme la notion de souveraineté dont le cadre d’application est tout sauf évident.
Pour mieux comprendre ce que peuvent apporter les pratiques alternatives, il est utile de rappeler quels sont les différents moyens de choisir ses représentants pour un groupe humain dès qu’il dépasse une certaine taille ainsi que les différents mécanismes permettant de prendre une décision. Ce choix peut se faire par l’élection, le moyen choisi aujourd’hui par la quasi totalité des pays ; par le tirage au sort pratiqué à Athènes au Vème siècle et toujours aujourd’hui pour désigner les jurys populaires ; enfin, par la désignation et l’engagement volontaire, comme dans les espaces militants – forums sociaux ou assemblées de type Occupy – ou qui relèvent de biens communs, comme dans le numérique. Quant aux procédures de décision, il n’y en a que deux, le vote et le consensus, qui n’est pas l’unanimité mais une décision prise par « consentement apparent »18, c’est à dire sans que ne soit exigé l’application d’un droit de veto.
Les pratiques alternatives sont d’une grande diversité, et plusieurs facteurs interviennent pour différencier leurs modèles de gestion. Le premier porte sur l’ouverture ou la fermeture des communautés dont nous parlons. Les biens communs qui permettent à leurs usagers de vivre de leur production – alpages, irrigation, coopératives ouvrières – sont tous fermés, seuls celles et ceux qui y ont un droit d’accès participent à leur gestion. À l’inverse les biens communs du numérique et les communautés constituées sur un objet ou un projet – écoféministes, forums sociaux du mouvement altermondialiste, assemblées des mouvements Occupy, occupation de grands projets inutiles comme les ZAD (zones à défendre) en France – sont ouverts, même si les décisions sont l’apanage de celles et ceux qui ont choisi de s’y investir sérieusement.
Autre facteur différenciant, le caractère public ou discret de leur fonctionnement. Les biens communs de la connaissance, comme les logiciels libres, considèrent comme essentiel le caractère public de leur production. À l’inverse, quand il s’agit plus de savoir-faire, comme le mouvement pour les semences paysannes, ou quand les auteurs de ces pratiques alternatives sont marginalisés ou stigmatisés, leurs pratiques s’exercent de façon discrète, pour ne pas dire secrète, et ne sont confiées qu’à ceux en qui ils ont confiance. Enfin la compétence est déterminante pour des communautés techniciennes comme les gestionnaires d’internet ; elle est présente à un degré moindre dans les communautés militantes mais considérée comme secondaire pour des biens communs du numérique comme Wikipedia.
L’importance donnée à la compétence fait que les processus de décision relèvent en réalité d’une démocratie de la méritocratie technique. L’internet est ainsi géré, sur le plan technique, par l’IETF (Internet Engineering Task Force), une structure qui n’a pas de statut légal, est ouverte à tous, et prend ses décisions sur les principes du consensus et du « code qui tourne », c’est à dire de la capacité de chacun à démontrer la validité de sa proposition technique. Les espaces militants comme les assemblées d’ONGs et de mouvements dans les sommets climat ou les Forums sociaux mondiaux, sont également ouverts à tous, mais la connaissance des langues, à commencer par l’anglais est un prérequis, de même que la compréhension de débats parfois très techniques, comme pour les négociations climatiques.
Le caractère public des développements en logiciel libre, considérés comme des biens communs de l’humanité, est à la base de leur existence. La « Free Software Foundation » définit les logiciels libres en fonction du respect de quatre libertés : celle d’utiliser ces programmes, de les étudier (qui rend nécessaire la publication du code constitutif des logiciels), de les distribuer et de les améliorer. D’autres biens communs de la connaissance, comme Wikipedia ou Openstreetmap, ne peuvent se développer que grâce à une codification claire et publique de leurs procédures, établissant ainsi une « démocratie procédurale » sur laquelle nous reviendrons.
Mais il existe également toute une série de pratiques qui relèvent souvent de savoir-faire ou sont exercées par des communautés marginalisées ou opprimées qui les protègent par la discrétion ou le secret. Les paysans qui utilisent des semences qui ont été sélectionnées par leurs communautés depuis des siècles ou certaines espèces animales domestiques, parce qu’elles sont particulièrement adaptées à leur territoire, refusent l’idée que celles-ci soient des biens communs de l’humanité. Ils craignent en effet, et l’histoire leur donne le plus souvent raison, que les institutions scientifiques d’État ne leur imposent l’usage de semences ou d’espèces normalisées au nom de la sécurité alimentaire et des nécessités productives ou, pire, que, pure bio-piraterie, des entreprises privées ne volent ces savoir-faire en les « protégeant » par des brevets. De même, certaines communautés gardent pour elles des pratiques de médecine traditionnelle ou des rites religieux ou communautaires qui sont rejetés, voire interdits, par les pouvoirs en place. On retrouve là des rôles dévolus aux femmes sur lesquels s’appuient les écoféministes et des pratiques sociales comme celles des communautés andines porteuses du buen vivir. Dans tous ces cas de pratiques confidentielles, on pourrait parler de « démocratie ésotérique », parce que ses règles sont réservées aux initiés, sont aux contours très variables d’un cas à l’autre, et dont les compétences ou le respect des traditions jouent un rôle important. Il n’est pas possible dans un chapitre aussi cours d’entrer plus avant dans leur présentation, mais il est clair qu’elles se placent au plus loin des pouvoirs étatiques.
S’il existe des biens communs ouverts à tous les contributeurs, comme ceux de la connaissance, d‘autres sont au contraire réservés à ceux qui en ont la propriété d’usage. C’est le cas des biens communs d’origine paysanne et des coopératives de production issues des luttes du mouvement ouvrier au XIXème siècle. Les pratiques démocratiques sont évidemment différentes dans ces deux cas. La limitation du nombre des bénéficiaires de certains biens communs permet d’envisager des votes, le périmètre électoral étant fixé et connu : c’est le cas des coopératives de production. Les lois peuvent être légèrement différentes d’un pays à l’autre, mais le recours au vote est en général la règle. En France, par exemple, la loi oblige les coopératives à tenir des assemblées générales et à avoir recours au vote pour l’élection des dirigeants, pour l’approbation du bilan et l’affectation des bénéfices. Dans certains cas, l’assemblée générale des associés est également décisionnaire pour les investissements les plus importants ou la prise de participation dans d’autres sociétés. À l’inverse, les espaces ouverts, ceux des biens communs ou des espaces militants du type forum social ou Occupy ne pratiquent quasiment jamais le vote, décident au consensus et celles et ceux qui participent aux processus de décision s’y engagent de façon volontaire.
De l’influence des procédures, compétences et stratégies sur les formes démocratiques
Les structures humaines collectives, qu’elles soient politiques, économiques, associatives ou culturelles, doivent être gérées, et cette gestion mêle toujours trois éléments de nature différentes : les règles et procédures, qui peuvent évoluer mais sont la loi commune à laquelle se réfèrent toutes les personnes impliquées ou concernées ; les compétences, qui peuvent être nécessaires à la gestion de la structure en question ; enfin, la stratégie au sens des objectifs qu’un collectif humain peut se fixer et des moyens pour les atteindre. Mais si ces trois éléments sont toujours présents, leur pondération et leurs poids respectifs peuvent être très variables et dessinent des formes démocratiques très différentes les unes des autres.
Si les procédures et règles communes sont inexistantes ou fragiles, les modes de gestion sont peu ou non démocratiques, donnant aux plus forts des marges de manœuvre considérables. À l’inverse, si la priorité absolue est donnée au respect des règles et lois communes, on peut parler de mode de gestion démocratique, mais il s’agit alors d’une démocratie procédurale d’où les questions de stratégie sont évacuées au profit du respect, parfois tatillon, des procédures. On retrouve cela dans beaucoup de communs, qu’ils soient issus des rapports de production précapitalistes, comme la gestion de l’eau dans les oasis ou des pâturages montagnards, ou du numérique comme Wikipedia. Dans les deux cas les stratégies sont inexistantes, l’eau ou les pâtures pour le bétail sont sensés être là de façon régulière et il n’existe pas de comité directeur pour Wikipedia qui déciderait d’une politique éditoriale. Il s’agit simplement de vérifier que tous les ayant-droit aient un accès équitable aux ressources naturelles ou que soient respectées les règles d’édition de la plus grande encyclopédie du monde.
Le rapport à la compétence a toujours été discuté dans les régimes démocratiques. Dans les débats qui ont suivi l’indépendance des États-Unis, les anti-fédéralistes plaidaient pour que les institutions représentent le peuple tel qu’il est, sans tenir compte de la compétence des uns ou des autres20. Dans les démocraties contemporaines, le système représentatif aboutit à la sélection des « meilleurs », c’est à dire de ceux qui sont sensés être compétents. Mais le discours continue à proclamer que la politique n’est pas un métier et que les représentations nationales devraient être beaucoup plus qu’elles ne le sont à l’image du peuple. Dans le même esprit, le suffrage universel a réglé la question de la compétence de l’électeur. Rien ne lui est exigé, tout citoyen a le droit, voire dans certains pays le devoir, de voter, quelle que soit sa compréhension des (et son intérêt aux) débats en cours ; une absence d’exigence qui est à la fois indispensable pour une démocratie qui veut impliquer le peuple dans sa totalité mais qui favorise la séparation représentants/représentés.
Les alternatives présentées ici n’ont pas la même approche – si l’on excepte les coopératives de production dont les règles sont proches de la démocratie représentative. Non que la question de la compétence en soit absente, mais parce que la séparation représentant/représenté, au cœur de la démocratie représentative, ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. La compétence est centrale dans les communautés techniciennes du numérique, comme les gestionnaires de l’internet ou les développeurs en logiciel libre. Leurs espaces sont ouverts, tout ceux qui le veulent peuvent participer à l’IETF ou au développement de tel ou tel logiciel libre, et s’il peut exister des représentants de ces communautés, leur rôle est extrêmement faible car tout y est décidé au consensus. Seuls comptent la compétence technique et le degré d’engagement dans ces communautés qui fonctionnent selon ce qu’on peut appeler une démocratie de la méritocratie technique. Les autres communautés présentées ici, qu’elles soient ouvertes – comme celles qui gèrent les contenus du numérique, Wikipedia ou Openstreetmap – ou expérimentent des modes de vie alternatifs – comme les groupes militants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou les communautés écoféministes de l’Oregon21 -, ou fermées – comme les communautés indigènes du buen vivir ou des communs précapitalistes – peuvent également faire appel à des compétences spécifiques, mais à un degré bien moindre, et fonctionnent au consensus avec des représentants aux rôles codifiés et limités et où le degré d’engagement est essentiel.
La stratégie est un concept récent en politique. Issu du monde militaire et codifié par Carl Clausewitz au début du XIXème siècle comme l’art de combiner les batailles pour obtenir un but politique, la stratégie est devenue omniprésente dès le XXème siècle dans le discours des entreprises comme dans celui des politiques. L’omniprésence de ce concept chez les responsables politiques renvoie à la conversion au libéralisme de l’essentiel des familles politiques des pays occidentaux à la fin du XIXème siècle. Une idéologie selon laquelle les sociétés peuvent décider de leur propre avenir, usant pour cela des ressources des sciences sociales et, surtout, des promesses d’un progrès dû au développement des sciences et des techniques. Dans les démocraties contemporaines, le suffrage universel est supposé être le moyen de trancher entre différentes propositions stratégiques qui dessinent le futur des sociétés. Nous savons que trop souvent ces propositions s’effacent après les élections, au profit de la soumission aux règles de la mondialisation néolibérale. Mais cela n’invalide pas l’intérêt de ce débat stratégique qui constitue l’atout essentiel de la démocratie représentative, un système dont nous avons par ailleurs souligné les défauts.
Les alternatives dont nous parlons échappent à cette approche. Les communautés indigènes ont une vision du temps non lié à une promesse de progrès et les communs précapitalistes dépendent avant tout du cycle des saisons. Pour des raisons un peu différentes, leur promesse étant avant tout liée à l’équilibre avec la nature, le résultat est le même pour les communautés militantes expérimentant des modes de vie alternatifs. Quant aux communautés du numériques, elles ont également évacué les questions stratégiques de leur modèle démocratique. Wikipedia a pour but de développer une encyclopédie en ligne dans le plus de langues possible. Mais, pour ce faire, elle refuse toute visée éditoriale et laisse la communauté des contributeurs produire des articles sur tous les sujets possibles, à condition de respecter les règles d’édition. Openstreetmap fonctionne sur le même modèle : chaque contributeur participe à l’effort commun en cartographiant ce qu’il veut, les seules « irruptions stratégiques » connues sont les cas de catastrophes, comme le tremblement de terre de 2010 à Port-au-Prince, en Haïti, ou la communauté a été mobilisée pour cartographier en urgence, à partir de toutes les sources possibles, une carte de la ville indispensable pour orienter les secours. Les communautés techniciennes de l’internet ou du logiciel libre se refusent également à toute orientation stratégique, les choix de développement sont faits par les individus et les collectifs, aucune planification centrale n’étant prévue par les communautés.
Conclusion : deux façons d’agir en politique
La démocratie est le plus souvent assimilée au respect du droit de vote et au pluralisme politique. Conscients de ces limites, les militants des diverses formations de gauche ont cherché à élargir son contenu en ne limitant pas la démocratie au temps de l’élection et aux mécanismes de la démocratie représentative. La démocratie participative, inventée à la fin des années 1980 à Porto Alegre, au Brésil, a été promue par le mouvement altermondialiste dans les années 2000, et de nombreuses municipalités de gauche l’ont mise en œuvre, sur tous les continents. D’autres extensions du champ de la démocratie ont également expérimentées : la démocratie directe avec les référendum d’initiative populaire selon le modèle helvétique ou la possibilité de révoquer les élus, pratiquée depuis plus d’un siècle dans plusieurs états de l’Ouest des États-Unis et, plus récemment, adoptée dans la constitution vénézuélienne. Mais tous ces dispositifs ne sont que des extensions, des améliorations, de la démocratie représentative et, comme celle-ci, ne permettent pas de répondre à des questions stratégiques par le vote des lois ou des propositions, pour ce est de la démocratie participative, portant sur l’organisation des services publics ou des questions démocratiques, sociales ou environnementales. Des améliorations importantes22 donc, mais qui ne relèvent pas des questions abordées dans ce chapitre.
Les pratiques alternatives décrites ici sont d’une autre nature. Elles ne posent pas les questions stratégiques qui sont au centre des systèmes politiques des démocraties contemporaines, mais sont pour autant profondément politiques. Elles considèrent que les individus et les collectifs qui les composent 23 sont les plus légitimes pour poser des questions et y apporter des réponses. Pour les acteurs et actrices du buen vivir et de l’écoféminisme, il s’agit de prendre soin de soi, des autres et de la nature dans un tout indissociable ; et pour ceux des biens communs, de gérer des collectifs qui produisent eux-mêmes des biens et de la connaissance. Au-delà de l’absence des dimensions stratégiques, ces pratiques démocratiques ont un certain nombre de points communs :
- la césure représentants/représentés n’existe pas ou est très limitée,
- le consensus est la forme préférée de prise de décision,
- l’engagement volontaire et le degré d’implication est essentiel, à l’évidence dans les communautés ouvertes mais également dans les biens communs à frontières établies où l’absence ou la faiblesse de l’implication des acteurs risque d’aboutir à la dégradation et la fin du bien commun en question,
- l’autonomie des communautés concernées vis-à-vis de l’État est décisive.
On a donc là une forme de politique basée sur la mise en action autonome de ces principes et pratiques. De la politique au quotidien qui crée de nouvelles frontières pour la démocratie par l’existence même de ces pratiques alternatives et qui peut également participer à la radicalisation de la démocratie représentative, sur au moins deux questions. Le gouvernement des technosciences, dont l’importance est croissante, est une co-construction des acteurs des sciences et des techniques, des institutions politiques et des acteurs de la « société civile »24. Mais il est clair que cette co-construction est dominée par les grandes entreprises et les institutions politiques qui leur sont proches.
Le développement de pratiques et de modes de vie alternatifs peut donner une toute autre orientation aux choix à prendre sur des questions politico-scientifiques comme les pratiques agricoles (semences, pesticides…) ou le changement climatique. La deuxième question concerne le droit, un aspect souvent négligé. À la source de la modernité occidentale et du capitalisme, on trouve deux mythes fondateurs : celui de la souveraineté sans limite de l’État, tel que Hobbes la définit dans le Léviathan, et l’institution de la propriété qui permet à John Locke de lier propriété privée exclusive et prospérité générale25. Entre souveraineté de l’État et souveraineté de la propriété privée, il n’y a pas de place pour les communs qui sont régis par un ensemble de droits et obligations qui relèvent d’autres logiques. Or, comme nous l’avons vu, les communs ont survécu et se sont développés rapidement, tout comme des modes de vie alternatifs que l’on rencontre sous différentes appellations sur tous les continents. Par leur existence mêmes, ces pratiques ont créé du droit, à l’image de la « general public licence » du logiciel libre, des « creative commons », des communs de la connaissance ou de la proposition du gouvernement bolivien d’adopter, à l’ONU, une charte des droits fondamentaux de la nature.
1 Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, Paris, 1995
2Karl Marx, La guerre civile en France, Éditions sociales, Paris, 1968.
3Christophe Aguiton, La gauche du 21ème siècle, Éditions La Découverte, Paris 2017
4Anton Pannekoek, Action de masse et révolution, Neue Zeit, 30ème année, 2ème volume, 1912
5Lenine, L’État et la Révolution, 1917
6Montesquieu, De l’esprit des lois, 1777
7David Graeber, La démocratie aux marges, infokiosque 2015
8Marcus Rediker, Villains of All Nations : Atlantic Pirates in the Golden Age, Beacon Press, 2011
9James C. Scott, Zoomia, l’art de ne pas être gouvernés, Editions du Seuil, 2013
10Christophe Aguiton, Le monde qui émerge, Editions Les Liens qui Libèrent, Paris 2017
11Elinor Ostrom, La gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Editions De Boeck, 2010
12Dominique Cardon é Julien Levrel, La vigilance participative, une interprétation de la gouvernance de Wikipédia, revue Réseaux #154, 2009/2
13Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. Editions Gallimard, Paris, 1983
14Pablo Solon, Le monde qui émerge, Editions Les Liens qui Libèrent, Paris 2017
15Boaventura de Sousa Santos, Les gauches du XXIème siècle, Editions Le bord de l’eau, Paris 2016
16Emilie Hache, Reclaim, recueil de textes écoféministes, Editions Cambourakis, Paris 2016
17Catherine Larrère, Reclaim, recueil de textes écoféministes, Editions Cambourakis, Paris 2016
18Philippe Urfalino, La décision par consentement apparent. Nature et propriétés. Revue européenne des sciences sociales, XLV-136, p. 47 – 70
19Paulin Ismard, La démocratie contre les experts, les esclaves publics en Grèce ancienne, Seuil, Paris, 2015
20Bernard Manin, Op. cité
21Emilie Hache, Op. cité
22Christophe Aguiton, Op. cité.
23Sandre Laugier & Albert Ogien, Le principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique, Ed. La Découverte, Paris 2014
24Dominique Pestre (sous la directe de), Le gouvernement des technosciences, Ed. La Découverte, Paris 2014
25Serge Gurtwirth & Isabelle Stengers, Le droit à l’épreuve de la résurgence des communs, Revue juridique de l’environnement, S1, 2016